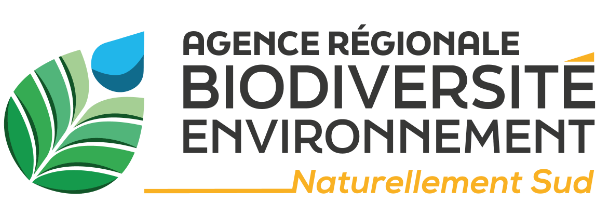Contexte
Les anciens salins (étangs et marais salins de Camargue) sont situés au sud-est de la Camargue, sur les communes d’Arles et des Saintes-Maries-de-la-Mer. C’est un espace lagunaire qui appartenait, de 1855 à 2008 à la Compagnie des Salins de Midi pour la production de sel.
Ces Salins ont été exploités industriellement entre 1950 et 1970, période durant laquelle les lagunes ont été fortement aménagées, à la fois à l’intérieur des terres pour contrôler la circulation de l’eau, les niveaux d’eau et de salinité (bassins, pompage,) mais aussi sur les parties littorales pour se protéger de la submersion marine et du recul du trait de côte (digues). Ces aménagements ont conduit à une poldérisation de cette partie de la Camargue.
A l’intérieur, les niveaux d’eaux étaient inversés par rapport au cycle naturel avec des hauteurs importantes en été, provoquant une salinité excessive, la disparition des végétations halophiles (sansouires), la mortalité des poissons et le déséquilibre entre espèces d’oiseaux (prolifération du Goéland leucophée).
En front de mer, les digues ont été inefficaces et ont même aggravé l’érosion naturelle du trait-de-côte en bloquant l’apport en sédiments et la formation des dunes. Sans entretien et rechargement régulier et coûteux, elles sont submergées par la mer qui ouvre des brèches dans les rochers. La montée du niveau marin accélère la vulnérabilité de ce territoire au changement climatique, 75 % de la Camargue a moins d’un mètre d’altitude.
Objectifs du projet
A partir de 2008, le groupe SALINS vend ces 6 500 hectares au Conservatoire du littoral. La production terminée, le Conservatoire du littoral et les gestionnaires (PNR de Camargue, Tour du Valat et Société nationale de protection de la nature -SNPN), ont de nouveaux objectifs :
- la restauration d’une hydrologie plus naturelle
- la gestion adaptative à l'élévation du niveau marin
- le maintien ou l’augmentation de la capacité d’accueil des oiseaux d’eau coloniaux
- la mise en œuvre d’une gestion adaptative à l’élévation du niveau de la mer, par un retrait maîtrisé et progressif du trait de côte dans les secteurs soumis à l’érosion
- la contribution au développement local, en facilitant le développement d’activités écotouristiques et de loisirs respectueuses de l’environnement.
Ces objectifs permettent progressivement de restaurer une vaste zone humide côtière, très riche en biodiversité, qui tamponne les intrusions marines.
Mesures mises en œuvre
A l’intérieur, il s’agit de rétablir les connexions hydrologiques, c’est-à-dire permettre une circulation naturelle de l’eau, gravitaire, entre les différentes lagunes, les milieux aquatiques voisins (étangs centraux de Camargue, sous-bassin versant du Rhône,) et la mer.
Un programme de restauration de lagunes temporaires est également mené, avec la réapparition de fourrés halophiles méditerranéens et de salicornes annuelles. Cela a nécessité des interventions assez lourdes sur le milieu mais la faune et la flore ont re colonisé spontanément les lieux et la concentration en sel a diminué.
Par ailleurs, des îlots artificiels ont également été aménagés pour favoriser la reproduction des oiseaux, en particulier les laro-limicoles coloniaux.
En front de mer, la gestion a consisté à stopper l’entretien des digues littorales (restauration passive) et à en déconstruire une partie. En effet, l'étalement de la mer sur une zone non habitée permet de réduire la submersion marine par absorption des ondes de tempête. Les côtes sableuses et plusieurs graus se sont reconstitués naturellement. En contrepartie, la digue à la mer (gérée par le SYMADREM et le groupe SALINS) plus à l’intérieur des terres, a été renforcée pour la protection des biens et des personnes.
Résultats obtenus
Sur l’ensemble du site, les résultats sont positifs avec de nombreux bénéfices retrouvés :
- écologiques : augmentation de la couverture végétale aquatique et terrestre, meilleure circulation des oiseaux et poissons migrateurs (dont l’Anguille d’Europe), protection des sols, purification de l’eau. Site à haute valeur écologique, labellisé Ramsar (17 habitats d’intérêt communautaire, 315 espèces de plantes (dont 25 protégées), 268 espèces d’oiseaux)
- sociaux : loisirs, éducation à l’environnement, source artistique et de recherche.
- économiques : 1 150 000 € de coûts, soit une économie de plusieurs millions en abandonnant l’entretien de digues, d’épis, et de stations de pompage sur le littoral. Coûts de la protection littorale en Camargue : Digue = 1800€HT/m, Épis(12) = 2500€HT/m, Brise-lames = 4000€ à 6200€HT/m, Restauration dunaire = 75€HT/m (Marobin D., 2009). Ces espaces ont changé de fonctions avec désormais de l’élevage traditionnel extensif, de la pêche professionnelle, des loisirs divers.
Points de vigilance et enseignements du projet
Accepter la mobilité du trait de côte n’a pas été facilement accepté par les acteurs du territoire (pourtant relativement peu nombreux), qui ont pour certain fondé leur identité et leur histoire sur l’extraction de ces terres à la mer. Cela a été le frein principal du projet.
Le sentiment d’être moins bien protégé sans les digues était aussi fort mais a été réduit avec le renforcement de la digue intérieure (renforcement en contradiction avec les nouvelles doctrines de l’état sur l’adaptation au changement climatique).
ll a également fallu reconsidérer l’accès au littoral. Auparavant accessible en voiture, il n’est désormais accessible qu’à pied. Les nouveaux plans de gestion (2023-2032) ont fait l’objet de concertations beaucoup plus larges.
Perspectives
La gestion du site est définie par un plan de gestion sur 10 ans (2023-2032), établi sous la maîtrise d’ouvrage du Conservatoire du littoral, et élaboré par un consortium constitué des co-gestionnaires et du CPIE Rhône-Pays d’Arles. Il a été validé par un comité de pilotage associant collectivités locales, services de l’État, associations et représentants des acteurs et usagers du territoire.
Un suivi écologique du site, notamment sur les ilots artificiels, est réalisé afin de surveiller son évolution, et évaluer l’efficacité des actions de restauration.
Face à l’évolution rapide du site ces dernières années, imputable à la fois aux modifications de sa gestion, à la dynamique du trait de côte et à la remontée du niveau de la mer associée à des événements météorologiques, des groupes de travail thématiques ont été initiés afin de mieux appréhender les dynamiques en cours, tant d’un point de vue géomorphologique que socio-économique, pour alimenter un processus de gestion adaptative et intégrée du site.