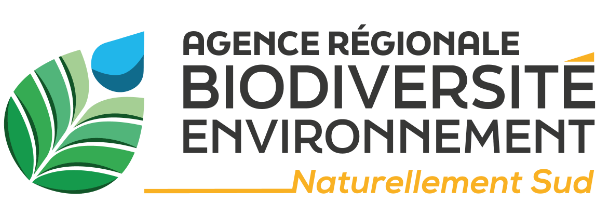La protection et la restauration d’écosystèmes dégradés contribuent à soutenir la biodiversité, stocker le carbone atmosphérique, réguler le climat local… Adapter la gestion de ces espaces de nature, favoriser leur résilience lorsqu’ils ont été dégradés et y ajuster nos activités permettent aussi de contribuer à notre qualité de vie, notre santé et nos loisirs. Comment, en tant qu’acteur du territoire, est-il possible d’atteindre ces objectifs conjoints ? Au travers d’exemples d’outils et d’actions menées sur différents territoires terrestres (forêts, ripisylves, zones humides) et marins (herbiers de posidonies), nous tenterons de vous inspirer.
Partie 1 : Enjeux et outils
- Panorama des outils de protection existants
Sylvaine IZE (DREAL) et Espoir BOUVIER (Région Sud) - Boite à outils des solutions fondées sur la nature : recommandations et ressources sur la restauration
Solène CUSSET (OFB)
Partie 2 : Retours d’expériences
- Création d’un îlot de biodiversité, développement et reconnexion de ripisylves en bord de Sorgues
Gilles PRIORESCHI (Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues) - Restauration de la zone humide du lac des Sagnes : faciliter l’appropriation des enjeux par les habitants en amont des travaux
Anne-Laure BARTHÉLÉMY (Conservatoire des Espaces Naturels de Provence-Alpes-Côte d’Azur) - Prévention incendie, pastoralisme et biodiversité : l’exemple de la commune d’Aureille dans le Parc Naturel régional des Alpilles
Lionel ESCOFFIER (Maire d’Aureille), Jean Michel PIRASTRU, Chargé de mission Biodiversité (PNR des Alpilles) et Sabine DEBIT, Ingénieure pastoral (CERPAM) - Restauration des herbiers de posidonies impactés par l'ancrage au large de Beaulieu-sur-Mer : le projet REPIC
Pierre DESCAMP, L’œil d’Andromède et Andromède Océanologie
Téléchargez les documents