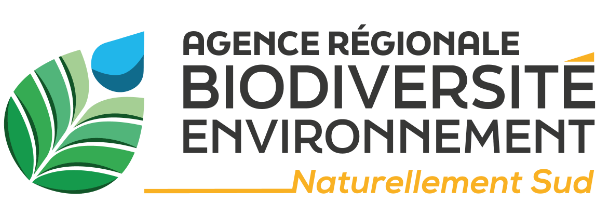La révision du PLU de la commune du Cannet des Maures, a été élaborée en respectant la procédure prévue par le Code de l’Urbanisme et le Code de l’Environnement. À ce titre, la réglementation est assez précise sur son déroulé.
Dans le cadre du lancement
Le travail avec le bureau d’études a été enrichi des données communales en présence et de rdv spécifiques avec les acteurs locaux, référents de quartier, services municipaux, permettant une première approche globalisante, témoignant des enjeux et contraintes du territoire. À ce titre, le rapport de présentation disponible à tous, est un document commun, concerté, définissant un cadre propice à la rédaction d’un PADD traduisant le « projet » souhaité.
Dans le cadre de la phase de concertation
Pour ce document de planification, la commune a souhaité concerter de manière plus large avec la population afin d’assurer une bonne compréhension et une appropriation des éléments. Ainsi, plusieurs réunions publiques ont eu lieu en 2020, avec la particularité de les retransmettre en direct sur internet, permettant, une connexion et une présence de près de 500 personnes, ce qui représente pour une commune de 5 132 habitants, une très large part de sa population. De même, des actions d’informations, de sensibilisation, de communication ont été lancées à travers tous les supports physiques (articles dans la presse locale, dans le journal trimestriel de la commune, sur les panneaux d’affichage, dans les bâtiments publics, création d’une exposition itinérante…) ainsi que sur les supports dématérialisés (réseaux sociaux, newsletter dédiée, site internet…). La tenue en mairie d’un registre, d’une adresse mail dédiée, à permis à qui le souhaite de se renseigner sur les objectifs, les modes d’implication de ce document cadre pour le développement communal.
Dans le cadre de la phase de consultation
Lors de cette phase, la commune a volontairement, augmenté le nombre de consultations des « Personnes Publiques Associées ». En effet, là où les textes tendent à consulter les services concernés publics, ou impactés directement, la commune a élargi ce champ de consultations, en y incluant, toutes les collectivités, les services de l’état ou parapublics, concernées par un intérêt direct ou indirect des propositions faites dans le document de la révision (phase arrêt). Mais, ont été aussi questionnées, les associations environnementales, en faveur des économies d’énergies, ou locales. De même, les acteurs des filières bois, ou de préservation directe des forêts ont pu déposer un avis sur le document de planification. En tout, une soixantaine d’acteurs ont été sollicités pour proposer des remarques qui ont été pour la quasi-totalité intégrée dans le rapport final.
Des outils de suivi/évaluation ont permis de quantifier cette consultation et concertation dans le but d’une part, d’assurer que l’implication de la population a été suffisante et d’autre part, de repérer en temps réels, d’éventuels « manques » dans le but d’agir de manière plus ciblée et de corriger en « direct ».
En matière de résultats, le PLU peut se quantifier par la production d’une feuille de route, d’un cadre concerté par tous, dans l’intérêt de tous.
Dans les faits, la résultante attendue en faveur de l’environnement est une meilleure prise en compte des enjeux de sa préservation.
Tant au niveau des cours d’eau, de la renaturation des espaces « urbanisés » que de l’intégration de démarches économes en énergie, en passant par une équité sociale, toutes les actions et prescriptions intégrées dans les documents du PLU tendent et visent à favoriser la préservation du territoire, passé et futur. La place du forestier comme socle de base à la tenue des écosystèmes a été prépondérante. À ce titre, les mesures favorables à l’environnement sont réglementées, par l’identification de « patrimoine vert », « d’arbres remarquables », par la création « d’espaces boisés classés » ou « d’espaces verts protégés », par la diminution des surfaces urbaines, par la diminution des emprises au sol en zone urbanisée (40 % à 30 %) (couplée à une densification verticale), par l’intégration des paysages identifiés, par la l’augmentation du coefficient d’espace vert, par l’obligation de plantation dans les aménagements et sur les parcelles, par la volonté de désimperméabiliser les espaces non en pleine terre, par la proposition d’espèces endémiques et l’interdiction d’espèces (allergisantes, espèces exotiques envahissantes), par la volonté de diversification, par l’interdiction de matériau plastiques...
Les premiers résultats se vérifient à travers les dépôts des autorisations d’urbanismes (compétence, mairie), et l’instruction de projets plus orientée vers le durable, et pour la préservation de l’environnement.